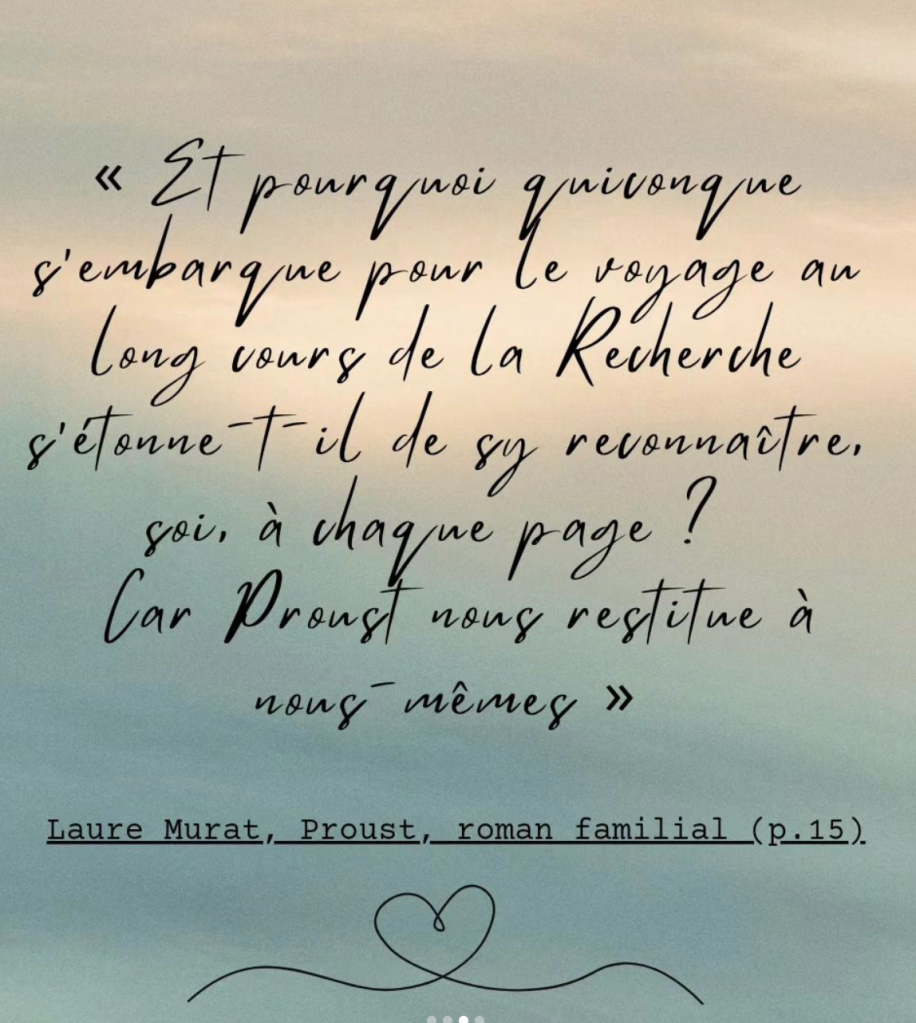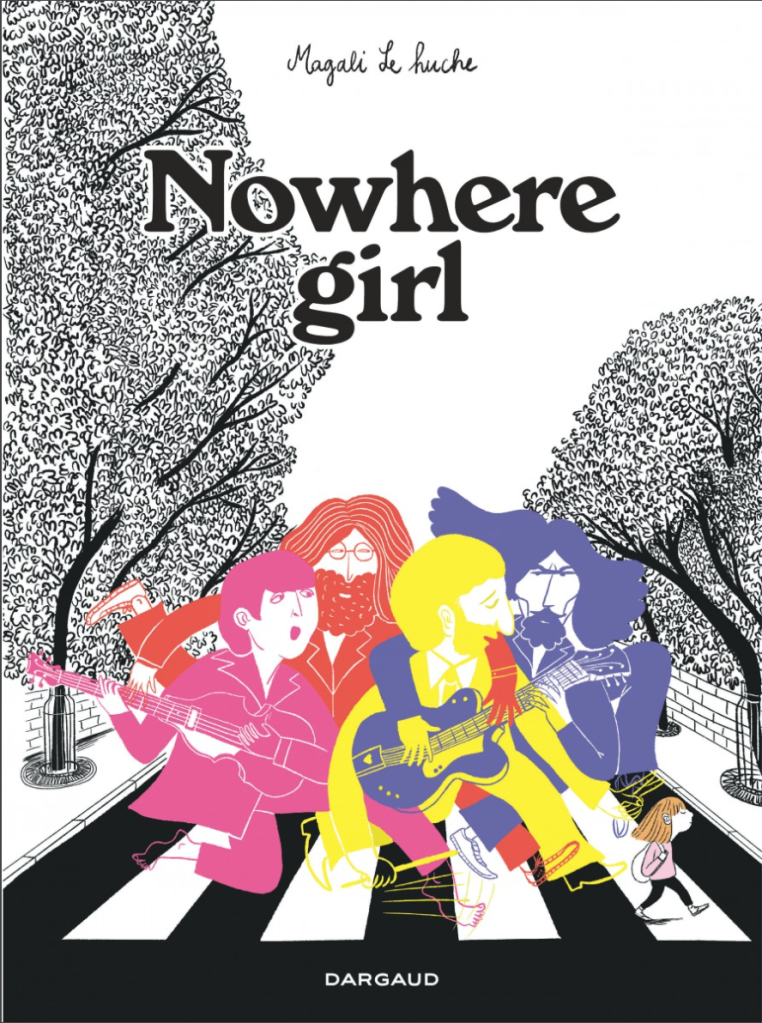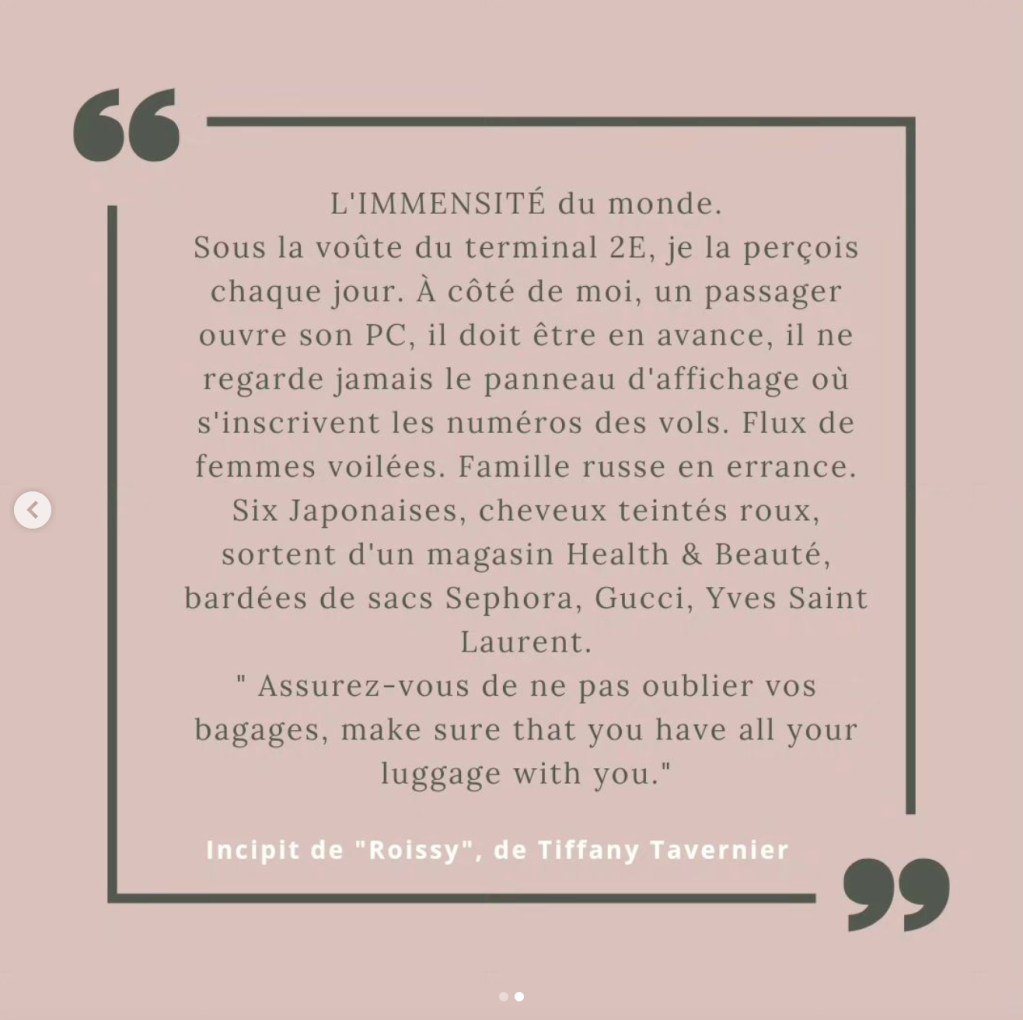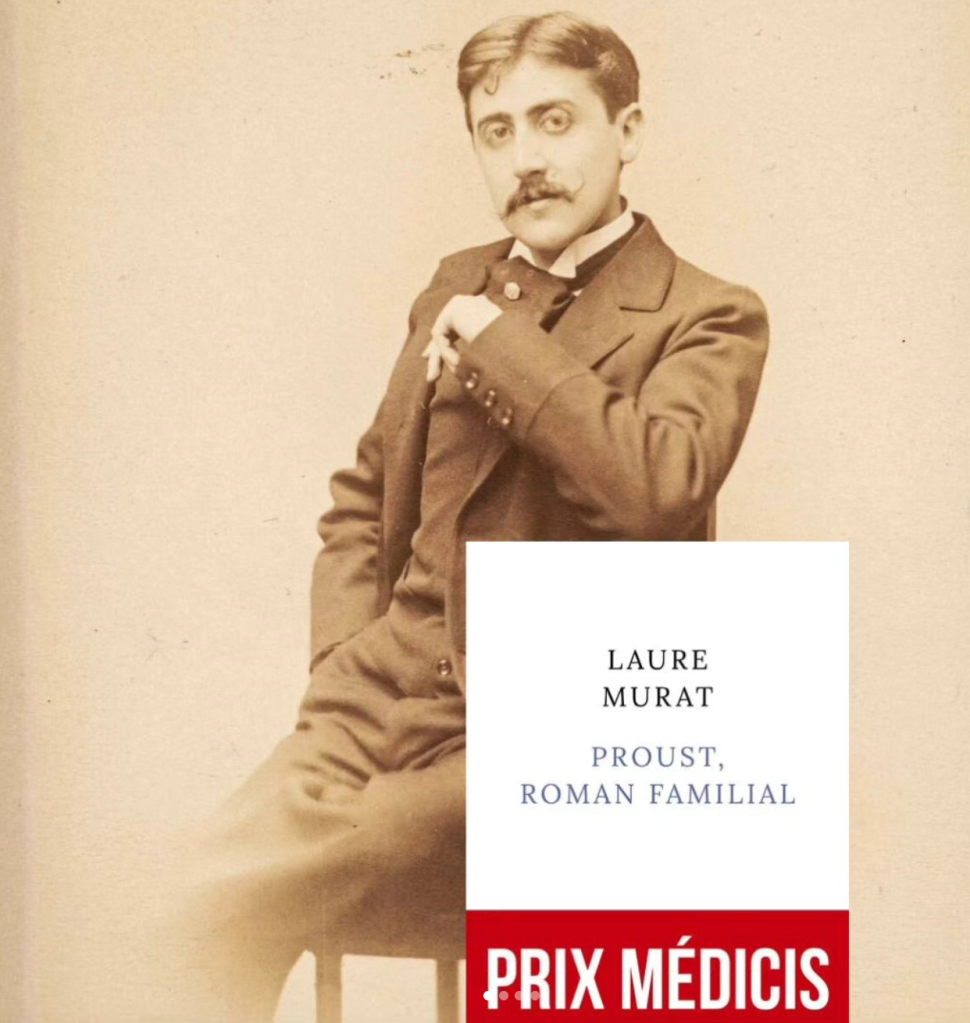
Chez Laure Murat, Marcel Proust fait partie de la famille. Non seulement parce qu’elle descend de cette aristocratie qu’il a tant dépeinte dans « À la recherche du temps perdu », mais aussi parce que ses propres arrières-grands-parents recevaient l’écrivain à leur table et le fréquentaient dans les salons parisiens. Quand Laure lut la Recherche à l’âge de 20 ans, elle eut l’impression de rencontrer des membres de sa famille dont elle avait entendu parler toute son enfance. Par le jeu des alliances où Proust mêle à plaisir les noms réels et les noms inventés, Laure Murat peut même en toute plausibilité adjoindre à son arbre généalogique les inoubliables mais néanmoins fictionnels « tante Oriane et oncle Basin » (le duc et la duchesse de Guermantes).
Mais s’il ne s’agissait que de cela, si l’autrice du présent texte se gargarisait de noms à particules et d’hôtels particuliers, si elle capitalisait sur le « proustige » (un terme forgé par Nicolas Ragonneau, dont je découvre à l’instant le très amusant blog Proustonomics, dont le dernier article est justement un billet commis par Laure Murat sur la « bibliothèque proustienne idéale » 😍) (ça fait beaucoup de « dont » 🙈), ce livre ne serait au fond qu’une pochade complaisante. Rien qu’une belle démonstration de « stéphanebernisation », comme dirait Ragonneau dont je vais bientôt ratisser le blog, je le sens.
Or l’essai de Laure Murat est tout l’inverse. Intelligent et remarquablement bien écrit, il montre combien lire Proust a été un « puissant outil de désaliénation sociale » dans sa vie. La lecture de la Recherche l’a en effet dessillée sur son milieu d’origine, une caste qui préserve jalousement son art de vivre et ses prérogatives contre vents et révolutions, entretenant des codes non-dits connus des seuls initiés afin de sembler flotter hors de portée des simples mortels. Proust vient jeter un grand coup de pied dans la fourmilière aristocratique en dévoilant tous les rouages de ce théâtre de pures formes « dansant sur du vide ». En ce sens, Proust l’a même « consolée » lors de sa rupture avec sa propre famille.
Mais elle dit aussi comme ce roman centré sur le microcosme du « Grand monde » parisien de la Belle Époque peut parler en tout temps à tout le monde, de l’Alaska à Tombouctou, tant il est une fabuleuse « tour de Babel » où chacun y retrouve un peu de soi. Proust offre les lunettes pour comprendre le mille-feuille de l’âme humaine tout comme le ballet des interactions sociales, que ce soit dans le cadre d’une cour de récréation ou d’un open-space !

Certains chapitres s’attardent sur l’histoire familiale de l’autrice ou celle de Proust. Il y a notamment un savoureux chapitre sur la présence furtive de Proust dans les archives de la police des mœurs. Dans un autre, elle essaie de retrouver le goût du « temps perdu » en traquant la façon de parler proustienne dans les enregistrements de Jean Cocteau et Paul Morand à la télévision française des années 1960, où ils imitaient la façon de parler « sinueuse et autoritaire » de l’écrivain qu’ils avaient bien connu. Comme l’autrice je suis fan de ce genre de « doubles saltos arrière » dans le passé qui me donnent de délicieux frissons.
Cet essai est du genre génial, de ceux qui, partant d’une expérience personnelle, éclairée par une œuvre littéraire, ouvrent à l’universel et font cogiter dans tous les sens (comme l’œuvre de Proust elle-même). Il donne envie d’arpenter la Recherche à nouveaux frais, avec un regard plus aiguisé !
PS : dans sa démarche, cet essai ressemble à celui de Lola Lafon sur Anne Frank. La concomitance (fortuite) de ces deux lectures m’a donné envie de les comparer. Ces deux essais font résonner une histoire personnelle et familiale à l’aune de la vie et de l’œuvre d’un écrivain. Dans les deux cas, ç’a même été une forme de thérapie. La grande différence réside dans les milieux sociaux aux antipodes des deux autrices. Si Laure Murat descend du grand arbre généalogique pluri-séculaire de l’aristocratie (dont les membres peuvent tous « se rattraper aux branches »), Lola Lafon descend de lignées juives d’Europe de l’est dont « l’arbre généalogique a été arraché » par les persécutions. Par conséquent, autant Laure Murat cherche à faire le deuil de son milieu d’origine en lisant et relisant Proust, autant Lola Lafon part en quête des moindres indices lui permettant de reconstituer l’histoire hachée de sa famille et de ceux qui lui ressemblent. À la fin, ça fait deux livres beaux et poignants, à la fois riches d’informations sur une œuvre littéraire et pleins d’enseignements sur la nature humaine.
« Proust, roman familial » de Laure Murat, éd. Robert Laffont, 2023, 251 p.